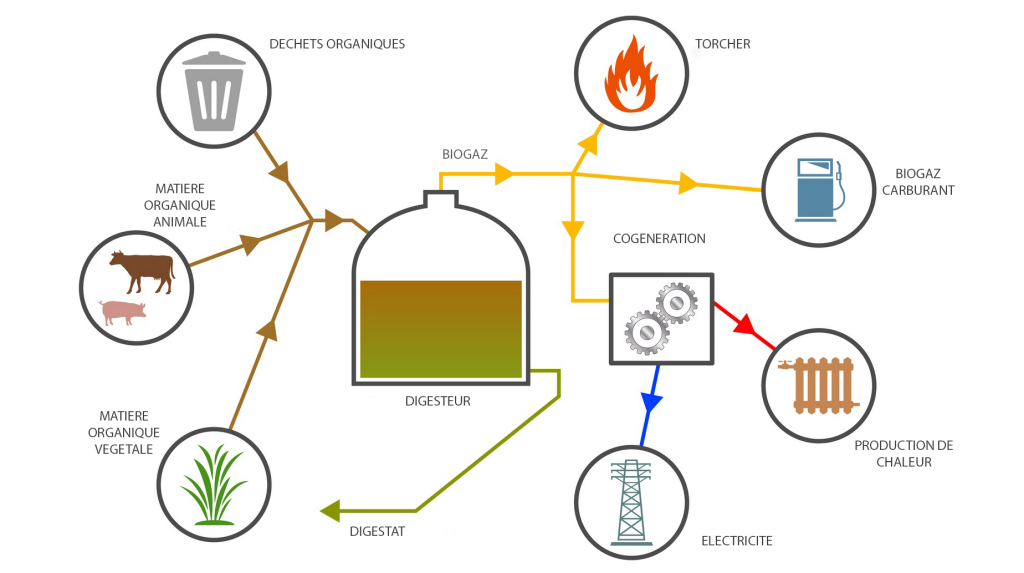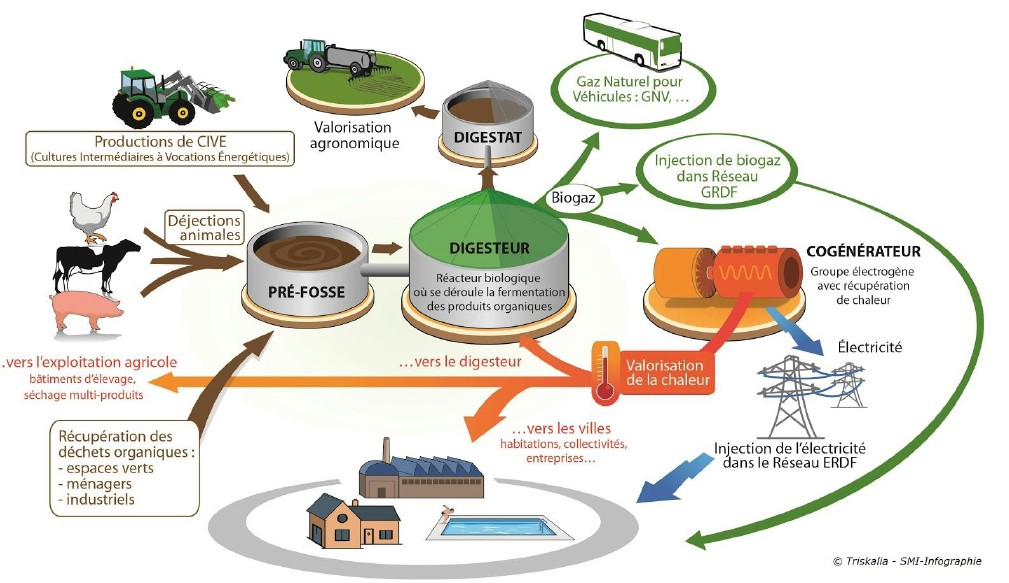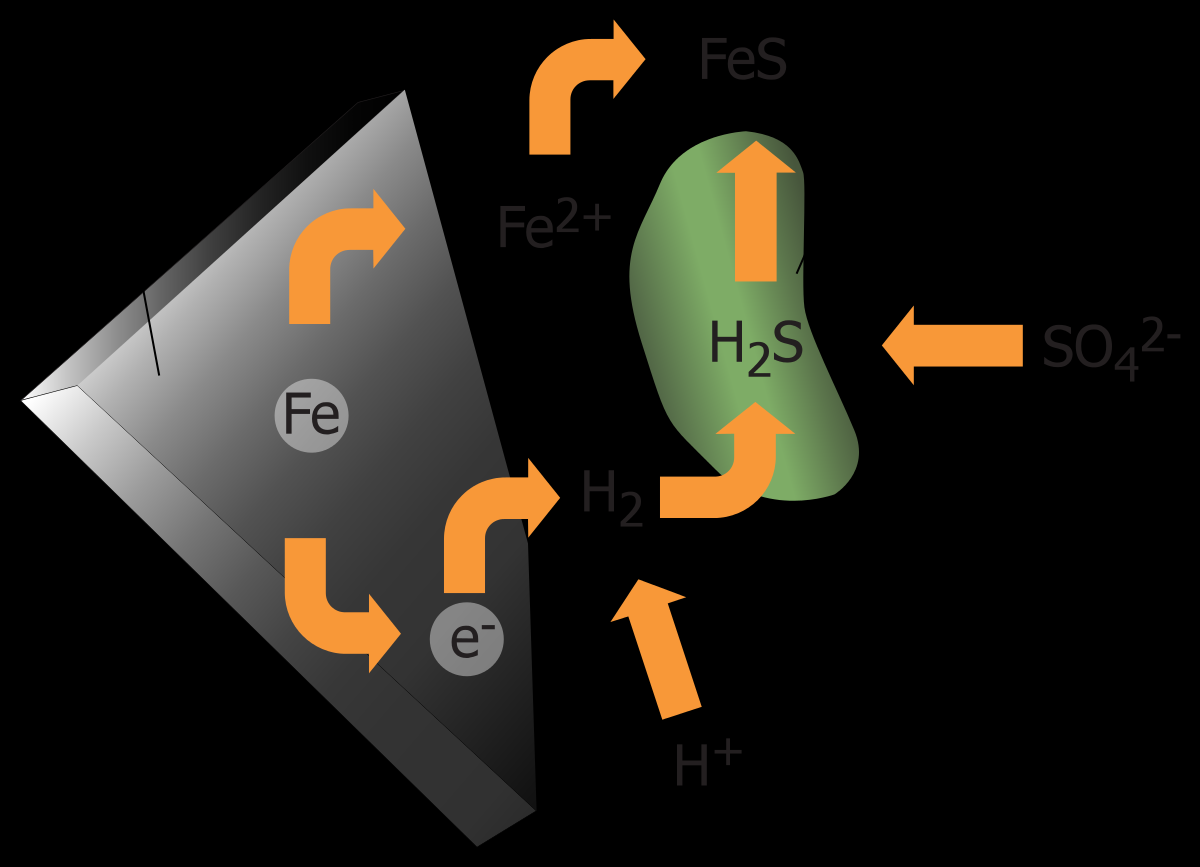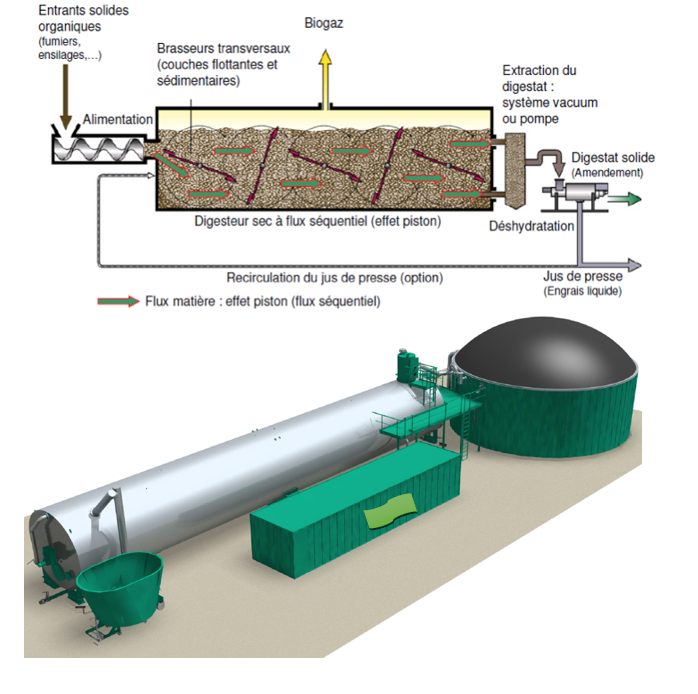Bon, revenons à notre histoire de compostage.
Comme évoquer précédemment plusieurs phases se succèdent dans le processus de compostage.
Etape 1, Dégradation :
Plages de température (20 à 70 °C) selon l'activité biologique dans le compost.
Pendant la phase de dégradation, la température augmente car il y a une forte activité biologique. Les composés les plus dégradables tels que les sucres, les acides aminés libres et l'amidon sont d'abord consommés. La décomposition de la matière organique fraîche se fait sous l'action de bactéries et champignons, dont l'activité fait augmenter la température jusqu'à 50 à 70 °C. La température monte rapidement à 40 - 45 °C à la suite de la respiration de micro-organismes mésophiles aérobies. La respiration élève ensuite progressivement la température jusqu'à 60 - 70 °C, ce qui conduit au remplacement des micro-organismes mésophiles par des thermophiles et des thermo-tolérants. La phase de dégradation voit la masse du compost diminuer par minéralisation de la matière organique en CO2, et par des pertes d'eau importantes par évaporation.
Etape 2, Maturation :
Pendant la phase de maturation, la température diminue. Après la phase dégradative, la quantité de matière facilement utilisable par la microflore s'est déjà raréfiée. Nous assistons alors à la disparition des micro-organismes thermophiles au profit d'espèces plus communes et de nouvelles espèces mésophiles. Au fur et à mesure, la température décroît et ce pendant une longue période de mûrissement, pour se stabiliser au niveau de la température ambiante. Le compost entre dans une phase de maturation constructive, pendant laquelle apparaissent lentement des éléments précurseurs de l'humus.
La transition entre chacune des phases citées précédemment résulte d'une évolution continue. Il n'y a pas de frontière marquée entre les espèces mésophiles et thermophiles. Chaque espèce possède une gamme de températures vitales avec un optimum au milieu.
Facteurs influençant le temps de transformation :
Le procédé de compostage et sa durée varient selon plusieurs facteurs comme :
La température
L’humidité
La teneur en oxygène
La taille des particules
Le rapport carbone/azote des résidus
Le mélange
Le retournement nécessaire
Ainsi, en plus d’être débarrasser des déchets verts, nous avons une matière riche en élément nutritifs (Humus).
Pour ce qui est des autres déchets ménager, le plus simple est de trier les ordures et de les recyclée.
Il est plus écologique et moins énergivore de recycler un élément en un autre que de le produire.
Cependant, cela n’est pas une action viable, les coûts sont chers et les demandes augmentent, il faudra toujours produire pour pouvoir recycler.